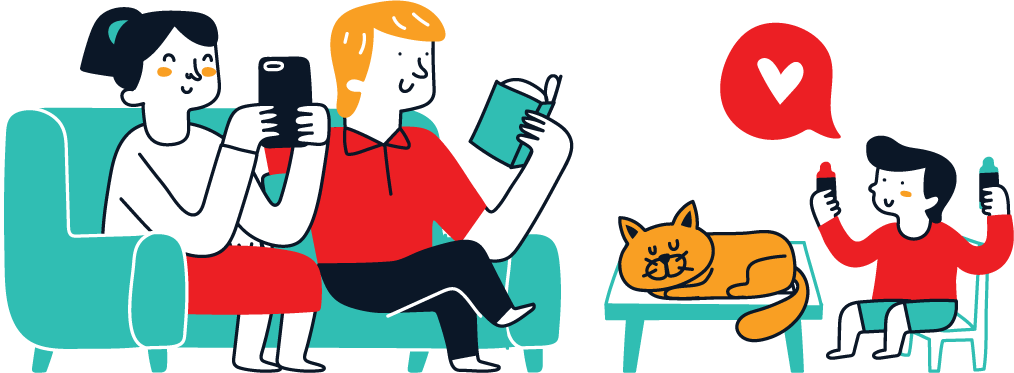Premier volet d’une série d’article préparatoire à l’université d’été du MNLE Réseau Homme&Nature fin août 2016. Lorsqu’on parle « SOL » évidement on pense agriculture. C’est le premier volet de ces articles préparatoires à la réflexion collective. Le « SOL » urbain comme celui des espaces industriels seront traité dans le prochain numéro de la Revue Naturellement.
DES SOLS VIVANTS POUR L’AGRICULTURE.
Occupant une position centrale dans les échanges entre lithosphère, hydrosphère, atmosphère et biosphère, les sols sont un milieu vivant encore largement méconnu. C’est aussi une ressource naturelle à la fois diverse, abondante, mais fragile et peu renouvelable. Si des sols fertiles ont été de tout temps la base des activités agricoles, les processus d’artificialisation et d’industrialisation en cours peuvent remettre ce lien en cause. Cible et réceptacle des pollutions de toutes sortes, les sols agricoles peuvent être érodés, appauvris, déstructurés, mais ils peuvent aussi être amendés, améliorés, enrichis. Les sols cultivés sont aussi de plus en plus menacés par la concurrence d’autres activités, stérilisant de manière quasi irréversible des surfaces considérables, et par des accaparements de terre. C’est pourquoi, pour la survie même de l’agriculture, des sols vivants doivent être protégés de pratiques destructrices comme de nouvelles formes de prédation et d’accaparement.
Du modèle de « polyculture élevage » aux forçages contemporains.
C’est avec la révolution agricole de la Renaissance (assolement quadriennal incluant des légumineuses fourragères, développement des élevages et des fumures associées) que se met en place, en France notamment, un modèle de polyculture-élevage libéré de la jachère, dans le cadre d’exploitations paysannes elles-mêmes libérées des droits seigneuriaux par la Révolution. Ce modèle, à la fois technique, économique et social, reposait sur une valorisation durable et équilibrée des agrosystèmes, dont les sols sont le cœur. Au cours du XXème siècle, avec le développement des villes et des transports, des spécialisations reposant sur la proximité des marchés (ceintures maraîchères), sur des conditions naturelles particulières (vins, fruits, légumes) ou encore sur des rentes différentielles de nature ‘sociale’ (rentes de notoriété et de monopole, appellations, labels) s’inscrivent durablement dans les paysages. Mais ces spécialisations poussées, – qui posent aux sols des problèmes encore peu abordés – ne concernent somme toute que des espaces relativement circonscrits.
La grande coupure, postérieure à la deuxième guerre mondiale, est celle qui a nettement séparé les productions végétales des production animales, de plus en plus spécialisées et organisées en filières de plus en plus étroitement définies. Cet éclatement du modèle de polyculture-élevage a été mis en évidence depuis quarante ans (FLEURY et MOLLARD en 1976, Claude REBOUL en 1977) : les symboles les plus éclatants en sont d’une part la Beauce livrée – comme d’autres régions du bassin parisien – à la ‘grande culture’ mécanisée, d’autre part la Bretagne largement dominée par les productions animales (bovins-lait, volailles, porcs). Les conséquences particulièrement préjudiciables et coûteuses de cette séparation étaient déjà clairement identifiées : aggravation des déficits humiques et azotés dans les régions de grande culture, accumulation de déjections organiques et d’azote (sous forme de nitrates notamment) dans les régions d’élevage. Mais dans le même temps la population se nourrissait plus et mieux, du fait de la très forte hausse des rendements par unité de surface, au travers de divers processus d’artificialisation.
Dès la renaissance, les agriculteurs ont en effet amplifié les ‘fonctionnalités’ naturelles des agrosystèmes par des artefacts qui leur ont permis d’accroître et d’améliorer les productions : recours à l’irrigation (de la rigole à l’aspersion), techniques de protection du gel et de recherche de la précocité (châssis, cloches maraîchères, serres) outils de travail du sol plus puissants (culture attelée notamment), techniques simples de fertilisation, sélection des variétés végétales et animales : c’est la première artificialisation, celle des Temps Modernes.
Peut-on pour autant parler d’agriculture « industrielle » ?
Ce faisant, ne prent-on pas le risque de renvoyer de l’agriculture et l’élevage contemporains une image inexacte, simplificatrice, trompeuse – voire imprudente – de l’agriculture ? Six motifs distincts incitent à refuser l’expression, proche d’un oxymore, d’agriculture industrielle.
Mais j’entends bien aussi ce que derrière l’impropre adjectif ‘industriel’ mes contemporains mettent en cause : une concentration de plus en plus poussée des terres et des capitaux, l’irrigation ou les traitements phytosanitaires systématiques, l’entassement de centaines, voire de milliers d’animaux dans des conditions où l’éthique animale est bafouée, la monoculture année après année d’un nombre restreint de clones de blé, de maïs ou de soja, la fuite en avant dans l’appel aux semences PGM résistantes aux herbicides, la présence croissante dans les sols et l’eau de molécules métalliques ou médicamenteuses indésirables, voire toxiques. Ce sont des inquiétudes que je partage, qui ne relèvent pas tant de l’industrie que du modèle technique productiviste.
Une place à part doit être faite aux ateliers d’élevage intensifs, parfois gigantesques, fortement industrialisés. Il s’agit ici, en effet, d’un deuxième ‘étage’ transformateur de productions végétales primaires. Les niveaux de concentration, de spécialisation et de standardisation relèvent d’une conception industrielle ‘du point de vue des animaux’, mais pas nécessairement ‘du point de vue des producteurs’. Il nous faudra y revenir. Mais ils représentent un premier pas dans la séparation entre activités agricoles et sols.
Un lien au sol de plus en plus distendu : du hors-sol aux pseudo-sols et au sans sol :
Dans les productions animales industrialisées la qualification de hors sol est classique, et en première analyse justifiée : en « logettes, en « cases » (individuelles ou collectives) en « batteries », les animaux sont confinés, parfois sur plusieurs niveaux, sans lien avec le sol, en effet. Mais le terme ‘hors sol’ est trompeur, dans la mesure où l’alimentation de ces animaux (fourrages secs ou déshydratés, grains, pulpes et tourteaux) dépend bien d’une agriculture ‘sur sols’ : mais il s’agit de sols très éloignés, provenant d’une autre région, voire de l’autre bout du monde : le soja sud-américain en est l’emblème… C’est l’aboutissement mondialisé de l’éclatement du système de polyculture-élevage : importations massives d’aliments du bétail, avec leurs composantes virtuelles (eau, nutriments, CO2) qui sont autant de prélèvements (donc autant de déficits à combler) d’un côté du monde ; de l’autre, l’accumulation d’animaux issus souvent d’un même clone (dont la vulnérabilité à divers bio-agresseurs impose des règles draconiennes du point de vue sanitaire) et dont les déjections, sans rapport avec les surfaces cultivables, entraînent les excédents d’azote (de phosphore, de résidus de pesticides et de médicaments) dans les nappes et les cours d’eau, jusqu’à la mer.
En production végétale, on peut aussi observer un détachement croissant du sol. Cette rupture se fait de manière progressive. On sait que toute récolte (qu’il s’agisse de grains, de fruits, de fourrages ou de légumes) est un prélèvement, qui entraîne un appauvrissement des sols. C’est le problème aussi vieux que l’agriculture de la reconstitution de la fertilité. Au 19ème siècle, l’agriculture française a eu recours à des apports de nitrates (du Chili), de potasse (d’Alsace) et aux scories de déphosphoration (de la ‘minette’ lorraine). Au 20ème siècle s’y sont ajoutés les engrais azotés de synthèse (ammonitrates, urée), d’autres apports minéraux (oligo-éléments) et diverses techniques (enfouissement des résidus de récoltes, cultures dérobées) corrigeant de leur côté les carences que les analyses de sols mettaient en évidence : on reste là dans le domaine de pratiques en principe améliorantes des sols existants.
De l’artificialisation des sols
C’est par le biais de cultures très spécialisées et très intensives que l’on passe à la fabrication de toutes pièces de sols artificiels, matériaux non pas vivants mais délibérément inertes (billes d’argile, vermiculite, perlite, laine de roche). Parties de la floriculture et de l’horticulture sous serres, elles ont gagné le maraîchage, y compris en plein air : un exemple encore peu étudié porte sur des pratiques courantes en Loire Atlantique, pour la production de mâches notamment : des sables marins pompés au large, transportés par bateau, sont lavés, puis épandus sur les parcelles maraîchères. De gros rendements à l’hectare, une mécanisation poussée, une productivité du travail élevée, un marché concentré entre quelques mains permettent de dégager des revenus substantiels. Ces pseudo-sols, simples supports de culture, doivent donc recevoir de l’extérieur tous les intrants utiles, engrais, produits phytosanitaires, oligo-éléments, dont les excédents non immédiatement retenus par les racines s’infiltrent rapidement vers les nappes. Une partie de ces sables, plus ou moins chargés en produits chimiques divers, finit aussi par les fossés et les petits affluents à gagner la Loire. On peut enfin se demander si ces substrats, chimiquement très pauvres, peuvent apporter aux produits récoltés les multiples éléments nutritifs que permettrait leur production en pleine terre. On entre dans des systèmes où la production alimentaire, en se détachant radicalement du sol, devient véritablement industrielle : ainsi les cultures hydroponiques en bacs et sur liquides nutritifs, classiques dans les productions maraîchères actuelles, allant jusqu’aux « usines à salades », aux « tours légumières » urbaines, où le soleil est remplacé par des leds. Outre les laboratoires qui les promeuvent et les firmes qui les exploitent, de tels modèles trouvent des partisans au sein de la mouvance écologiste. Des systèmes comme ‘l’aquaponie’, associant pisciculture et cultures de légumes à partir des déjections des poissons peuvent être donnés en exemple au nom de la santé, de la qualité, de l’économie circulaire et du circuit court, et bien entendu du changement climatique. Certains intégristes y voient une sorte de solution finale pour l’agriculture, par définition pollueuse et prédatrice, la production de nos aliments pouvant être désormais assurée dans des conditions d’hygiène parfaite et de contrôle intégral de leur composition : et cette agriculture 4S (sans sol et sans soleil) permettrait enfin de rendre à la « vraie nature » toutes les terres qui depuis le néolithique lui ont été arrachées pour la production de notre nourriture. Prenons bien la mesure des illusions que suscitent ces « fermes verticales » séduisantes au premier abord, mais incapables de répondre aux besoins alimentaires des métropoles, tout en rompant totalement le lien nécessaire entre nature et sociétés humaines.
Retrouver le lien étroit entre l’agriculture et les sols.
La meilleure protection contre la fuite en avant productiviste pourrait bien être le maintien d’un lien étroit entre l’activité agricole et les sols existants, préservés, amendés, enrichis. Renouer avec l’association de l’agriculture et de l’élevage y contribuerait. Passéisme, ou revivification d’un contrat tacite qui a fini par échapper aux agriculteurs ? Dès son ouvrage fondateur « nourrir la planète », Michel GRIFFON opposait aux préceptes de la ‘révolution verte’ « où la synergie agriculture et élevage n’est pas recherchée » une ‘révolution doublement verte’ faisant de cette synergie un principe de base. De son côté Marc DUFUMIER ne manque jamais non plus de rappeler, parmi d’autres, l’importance de ce lien. Mais ils promeuvent aussi l’un et l’autre une « 3ème voie entre l’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique », celle des « systèmes intégrés », d’où l’élevage est absent. Le poids politico-économique de la grande culture et des organismes qui lui sont liés expliquent sans doute cette timidité à en finir avec une séparation née pourtant des « errements du passé ». L’obsession climatique (qui s’exprime dans la ‘smart agriculture‘) et la chasse systématique à tout gaz à effet de serre joue sans doute son rôle dans la suspicion jetée sur toute forme d’élevage, voire sur toute viande, et en premier lieu sur les viandes dites rouges, provenant de poly gastriques (bovins, caprins ovins et autres ruminants) en effet émetteurs (via le rumen) de méthane, mais capables de se nourrir d’herbes et de fourrages grossiers.
On ne sortira pas facilement du modèle de la grande culture mécanisée, fort de son ancienneté et de ses incontestables réussites techniques et économiques, peu mobile du fait des lourds investissements qu’il suppose. Il n’est certainement pas possible ni même souhaitable de contraindre tel céréaliculteur « performant », au genre de vie aussi enviable que contesté, à se reconvertir à l’élevage laitier sur herbe. L’intégration culture-élevage peut aussi s’opérer au niveau des territoires, bassins versants ou petites régions agricoles, sans oublier les échanges entre bassins légumiers littoraux et couronnes péri-urbaines maraîchères d’une part, régions de basse montagne spécialisées dans l’élevage d’autre part. La formule des Groupements d’Intérêts Economiques et Environnementaux (GIEE) institués par la « Loi d’Avenir » pourrait ouvrir une perspective en ce sens, pour peu qu’une véritable volonté politique puisse les porter. Le dernier objectif – officiellement promu – d’augmenter annuellement de 4 pour mille le taux de matière organique des sols agricoles pourrait aussi y contribuer.
Pierre Lenormand